
Instantanés de Margaret Price au Palais Garnier : standing ovation au troisième acte des Noces de Figaro, après l’air « Dove sono » ; idem après le « Per pieta » de Cosi fan tutte, le chef Josef Krips s’impatientant dans la fosse et faisant de grands gestes pour que les gens se rassoient. Pluie de fleurs à la fin de Don Giovanni, qu’elle partage avec Kiri Te Kanawa ; atmosphère électrique entre elle et Jon Vickers pendant le duo du premier acte de l’Otello de Verdi. Tandis que l'Opéra de Paris fête Rolf Liebermann, « sa » chanteuse s’en va, à soixante-neuf ans. On garde ses disques, pas assez nombreux : la Comtesse des Noces avec Riccardo Muti (mais enregistrée trop tard), Fiordiligi dans Cosi avec Otto Klemperer, Donna Anna de Don Giovanni avec Georg Solti (mais les autres ne sont pas à son niveau), Desdémone d’Otello, toujours avec Solti (et les excellents Carlo Cossutta et Gabriel Bacquier), tous ses récitals avec piano, et puis, bien sûr, cette Isolde qu’elle n’aurait jamais pu chanter sur scène, mais que Carlos Kleiber drape dans la soie et l’or. Gros regret : elle n’avait pas été retenue pour le Don Giovanni filmé par Joseph Losey. Question de physique et non de voix. Parce que Margaret Price, qui avait commencé mezzo et s’était lancée en remplaçant Teresa Berganza en Chérubin au Covent Garden de Londres, possédait une des plus belles voix de soprano jamais entendues.
François Lafon
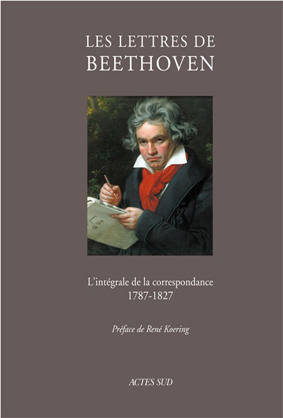
Encore une intégrale de Beethoven : pas celle de ses œuvres, mais de ses lettres. Actes Sud reprend en fac-similé une traduction française de 1968 (mais jamais rééditée) de la correspondance du compositeur. Une somme un peu intimidante : qui, outre les passionnés ou les chercheurs, a envie de plonger dans ces centaines de pages ? D’autant que Beethoven n’avait pas ce qu’on peut appeler un beau style. Parfois les missives ont la concision d’un SMS (surtout quand il s’agit de demander quelque chose à Ferdinand Ries ou Anton Schindler, ses collaborateurs les plus proches), parfois elles prennent un air plus pompeux pour s’adresser à l’un de ces mécènes qui l’ont soutenu parmi l’aristocratie viennoise. Mais si une à une ces lettres sont rarement passionnantes (Beethoven se faisait mieux comprendre avec les notes qu’avec les mots), l’ensemble donne une idée du métier de compositeur dans la Vienne du début XIXème siècle et de la lutte qu’il a du mener chaque jour : il réserve ses meilleurs compliments et insultes pour ses éditeurs (tour à tour extraordinairement dévoués ou ineptes), se préoccupe du manque de copistes « qui connaissent bien [son] écriture », et les erreurs dans les éditions le mettent hors de lui. Sa personnalité se dessine aussi dans ces documents. Pas mal égocentrique, il lui arrive de parler de lui-même à la troisième personne (« Beethoven ne jette pas de la poudre aux yeux et n’a que dédain pour tout ce qu’il n’obtient pas directement de son art et de son talent. ») et n’arrête pas de se plaindre de ses maux de tête, de ses diarrhées... Pas une lettre qui ne soit aussi un bulletin de santé, avec une attention particulière aux progrès de sa surdité à partir du fameux Testament de Heiligenstadt où le compositeur avoue son malheur. D’autres documents célèbres (la « Lettre à l’Immortelle Bien Aimée », par exemple) se fondent dans cet épais ouvrage qui recueille 1750 lettres. Trop ? Une suggestion : les lire en écoutant en parallèle chronologique les œuvres de Luwig van B.
Pablo Galonce
Les Lettres de Beethoven. L’intégrale de la correspondance 1787-1827. Actes Sud, 1746 pages, 49 euros.

En 3D, comme Avatar : c’est le petit plus inauguré par l’English National Opera pour la retransmission, en direct sur la chaîne TV Sky 3D et en salles, de sa nouvelle production de Lucrèce Borgia de Donizetti. Le cinéaste Mike Figgis (Leaving Las Vegas), qui met le spectacle en scène, a même imaginé, en plus des entractes avec visite des coulisses et interviews des chanteurs, des interludes filmés racontant la jeunesse de l’illustre empoisonneuse, composés, entre autres, d’extraits de la Lucrèce Borgia d’Abel Gance avec Edwige Feuillère (1935). Le 5 mars, la Carmen du Covent Garden sera donnée en salles en 3D, mais pas en direct. L’opéra sur écran n’est plus un ersatz, et offre davantage que le spectacle live. Davantage ? Et la voix au naturel, et la présence scénique, et la sensation d’assister à une aventure unique ? Ne tremblez pas, chers abonnés : en 3D ou non, les caméras ont encore besoin (pour combien de temps ?) d’avoir quelque chose à filmer.
François Lafon
Lucrezia Borgia, du 31 janvier au 3 mars à l’English National Opera, Londres. En direct le 23 février sur Sky Art 2, Sky 3D et des salles de cinéma. (Photo extraite du film d'Abel Gance)

« On ne part pas d’une conception. On n’analyse pas le texte pour arriver à une conception. Je n’ai pas de conception. Je ne suis pas à ce point prétentieux. J’essaie de voir quel est le matériau que j’ai dans les mains. J’essaie de l’analyser et d’en tirer des conséquences. La réponse que je fais toujours quand on me dit : « C’est tellement nouveau ! », c’est : « Non, c’est ce qui est écrit dans le texte ».
« Il y a un plus grand orgueil à analyser correctement ce qui est écrit qu’à l’interpréter. Quand je dis : « C’est écrit dans le texte », ce n’est pas pour me retrancher derrière. Eventuellement, c’est pour le plaisir de surprendre les gens qui ne l’avaient pas lu exactement de cette façon-là, et ça, c’est mon orgueil, l’orgueil d’avoir analysé le texte correctement et de me servir uniquement des mots qui sont écrits et de la musique qui est écrite. »
« Je pars d’une analyse du texte et de ses différentes composantes, étayée par les connaissances que j’ai essayé d’acquérir. Mais ce qui serait ma pure interprétation est beaucoup moins intéressant que la compréhension que j’acquiers du texte que j’ai sous les yeux, du matériau que j’ai à travailler, en essayant de régler ce problème : comment fabriquer cet objet, qui est un spectacle, avec le texte que j’ai et pas avec un autre que je m’inventerais. »
« Quelquefois, un concept n’entre pas dans la mise en scène. Il reste à l’extérieur. Un concept, une conception, comme toute interprétation, doit s’incarner dans les mots et produire des évidences, ou pas. »
« A partir du moment où tu te concentres sur des symboles, tu n’as plus besoin de te fonder sur le texte. Tu te fondes sur ce que tu inventes, et le texte n’est plus utilisé que pour justifier ta mise en scène, ta propre interprétation. C’est la même chose avec la musique. On ne peut pas faire cela. Je n’ai jamais mis en scène des symboles, je ne sais pas ce que c’est. Je mets en scène des personnes, des corps véritables, leurs dialogues, leurs discussions. »
Extraits de : Daniel Barenboim-Patrice Chéreau, dialogue sur la musique et le théâtre, Tristan et Isolde, chez Buchet-Chastel, à propos du spectacle donné à la Scala de Milan en 2007 (DVD chez Virgin Classics).
Avis aux amateurs de regietheater sauvage. Comme dit le maestro Stanislas Lefort - alias Louis de Funès -, dirigeant Berlioz dans La Grande Vadrouille : « J’ai ma conception personnelle de l’oeuvre, moi ! »
François Lafon

A ma droite (rien de politique) : La Musique classique pour les Nuls. Un coffret au format livre, un livret de cent pages, six CD d’extraits issus des catalogues EMI et Virgin. A ma gauche, Les Clés du classique, un album de quarante-cinq pages au format CD, deux CD d’extraits tirés du catalogue Universal. Pour les fêtes, le premier a cartonné, le second beaucoup moins. La collection Les Nuls est un best seller toutes catégories, alors que le seul titre Les Clés du classique sent son interrogation écrite, et n’est porté par aucun succès éditorial, en dépit de l’étiquette jaune Deutsche Grammophon qui figure sur la couverture. Les deux produits sont sérieux : texte anglais largement revu par l’excellente Claire Delamarche pour le premier (elle avait déjà « amélioré » L’Opéra pour les Nuls), explications claires mais moins ludiques pour le second. Handicap pour Les Nuls : le répertoire va du grégorien à Phil Glass, mais les extraits sont très courts, et il est rare qu’on ait un droit à un mouvement entier. L’album DG commence à Vivaldi et s’arrête à Chostakovitch, les extraits sont nettement moins nombreux (trente-cinq contre cent-quarante-sept) mais ils sont plus longs, et plus rarement shuntés. Léger avantage à DG pour les interprétations (Karajan, Abbado, Giulini, Boulez), alors que celles des Nuls sont en général dignes de la qualité EMI, mais parfois stylistiquement dépassées (Rameau par Cziffra). Alors, qu’offrir aux têtes blondes (ou même aux bruns mûrs) pour les faire entrer dans le monde enchanté de la « grande » musique ? Pour l’exhaustivité, l’étendue du répertoire et l’attrait du texte, Les Nuls bien sûr. En espérant que les impétrants auront envie d’aller plus loin que les mini-extraits : une des grandes différences entre le classique et la chanson, c’est que le classique, c’est plus long.
François Lafon
La Musique classique pour les Nuls : un coffret de 6 CD EMI/Virgin, 147 titres, un livret de 100 pages – Les Clés du classique : 2 CD, 35 titres, un livret de 45 pages Deutsche Grammophon/Universal.

Emily Howell n’a pas très bonne presse, aux Etats-Unis. Les critiques reprochent à ses œuvres de manquer d’âme. Sa maman Emmy n’était pas aimée non plus, elle qui avait pourtant composé cinq mille chorals de Bach en une après-midi. Elle s’en moque, puisque, comme Emmy (alias Experiment in Musical Intelligence), elle est un programme informatique. Sa mémoire couvre une longue période, de Palestrina (1525 – 1594) à David Cope, son concepteur, né en 1941. C’est en séchant sur un opéra, dans les années 1980, que Cope a sauté le pas. Il a découvert que toute musique n’était que plagiat, que les grands compositeurs étaient ceux qui recombinaient le matériel existant de la manière la plus inattendue, que le génie de Bach lui-même consistait à jeter un peu de hasard dans un océan de prévisibilité. « A ceux qui me disent qu’il n’y a pas d’âme dans les œuvres d’Emily Howell, je montre une partition, et leur demande où est l’âme dans toutes ces notes. Ce que nous ressentons en écoutant de la musique, c’est nous qui le produisons. » Il y a quelqu’un qui s’intéresse beaucoup au travail de Cope, c’est Douglas Hofstadter, l’auteur du livre Gödel, Escher, Bach, les brins d’une guirlande éternelle (1979, paru en France en 1985). « Je me suis rendu compte, expliquait Hofstadter à l’époque, que le logicien Gödel, que le plasticien aux constructions impossibles Escher et que Jean-Sébastien Bach n’étaient que des ombres projetées dans différentes directions par une essence centrale. J’ai essayé de reconstruire cet objet central ». Son travail, à l’époque où l’informatique n’était pas encore entrée dans les moeurs, a fait sensation. Le mystère de la création était à portée de main. Trente ans plus tard, la grande énigme n’est toujours pas résolue, et Cope s’en tient à des considérations plus bourgeoises. Il vend des disques : Emmy, Bach by design, Virtual Mozart, Virtual Rachmaninov ont été des succès, le premier d’Emily, Des ténèbres, la lumière, sorti cette année, marche bien.Cope répond, quand on lui demande pourquoi il ne se contente pas de composer sa propre musique, d’être lui-même son propre ordinateur : « Les programmes sont des extensions de ma personnalité. Pourquoi passerais-je six mois à chercher une solution que je peux trouver en une matinée ? On ne creuse plus avec les doigts depuis l’invention de la pelle. Au cours des dix prochaines années, ce que j’appelle la musique algorithmique sera un des piliers de notre vie ». Les apprentis sorciers de l’Ircam ne parlent pas autrement, mais ils utilisent l’informatique à autre chose qu’à produire des « à la manière de… ». Au moins Cope contribue-t-il à lutter contre la crise du disque : en se fondant sur ses recherches, des chercheurs des universités de San Diego et de Sao Paulo analysent les genres et rythmes musicaux pour découvrir quelles musiques nos contemporains sont susceptibles d’aimer, donc d’acheter.
François Lafon
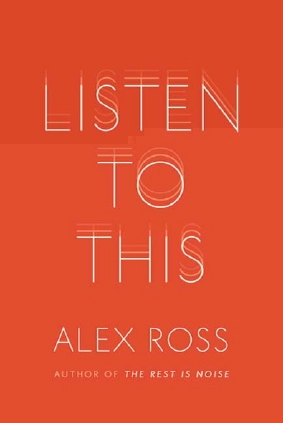
« Je hais la musique classique : pas la chose mais le nom. » C’est avec cette entrée en matière qu’Alex Ross démarre son nouveau livre. On retrouve le sens de la formule de l’auteur qui a réussi avec The Rest is noise à raconter la musique contemporaine comme un roman. Comme son livre a fait un carton, le critique du New Yorker (le très branché magazine américain où Ross travaille depuis dès années) a donc eu l’idée de ramasser quelques articles et essais dans ce Listen to this (Ecoutez ceci*) qui vient de paraître en anglais et dont attend déjà la traduction française. Cette anthologie a les mêmes qualités que son opus précédent : esprit didactique sans renoncer à la complexité, choix de l’anecdote révélatrice. On peut seulement lui reprocher de trop utiliser la première personne (mais c’est devenu presque un cliché dans la presse américaine) et de s’appuyer uniquement sur des auteurs anglo-saxons. Mais comme dans The Rest is noise, c’est surtout le point de vue original qui fait le prix de ce livre : qu’on le veuille ou pas, le « classique » doit aujourd’hui vivre avec le rock, le pop, le jazz et qui sait quoi encore à l’avenir. Pourquoi donc pas en profiter ? « La meilleure interprétation classique n’est pas un retour dans le passé mais une intensification du présent. L’erreur que les apôtres du classique ont toujours faite est d’avoir uni leur amour du passé à leur dégout du présent. La musique a d’autres idées : elle hait le passé et veut y échapper ».
Le lecteur déjà familier de ces compositeurs n’apprendra rien de nouveau sur Mozart ou Schubert (quoique ces chapitres soient fort bien écrits), mais en revanche il pourra suivre l’élaboration d’un album de Björk où la chanteuse islandaise brasse la musique populaire de son pays avec Stockhausen. Pas de révélations sur Brahms, mais un portrait passionnant de Bob Dylan où Alex Ross confesse ne rien comprendre souvent aux textes du chanteur. Si sur les opéras de Verdi tout semble avoir été dit, on découvre en revanche qu’il y a du Messiaen dans les chansons du groupe britannique Radiohead. On part aussi en voyage pour découvrir l’œuvre d’un compositeur qui veut mettre les paysages de l’Alaska en musique avant qu’ils ne soient emportés par l’urbanisation et le réchauffement de la planète, suivre un quatuor à cordes dans le Texas pour se rendre compte que la vie musicale aux Etats-Unis est plus riche qu’on ne le croit, et parcourir la Chine, le pays qui, malgré ses conservatoires remplis par des millions d’élèves, ne sera pas peut-être la Mecque du classique comme certains l’ont prophétisé trop rapidement. Alex Ross lui-même se garde bien de prédire quoi que ce soit sauf que « toute musique devient finalement de la musique classique. »
Pablo Galonce
Alex Ross, Listen to this. Farrar, Straus and Giroux, New York. 364 pages. www.fsgbooks.com
* Pour que la promesse du titre soit pleinement réalisée, Alex Ross a mis sur Internet un guide d’écoute pour chaque chapitre.

Golden Gate Award à San Francisco, Prix de la semaine de la critique au festival de Locarno, nomination à la European Film Academy. « Un film sur l’amour, la perfection et une note de folie », annonce l’affiche. En vedette : Lang Lang, Alfred Brendel, Pierre-Laurent Aimard, Till Fellner et … Stefan Knüpfer. Présenté partout, salué partout, Pianomania sort en salles. Pourquoi en salles, alors que ce documentaire d’une heure et demie sur le travail des pianistes sus-cités avec l’accordeur de la maison Steinway à Vienne (c’est lui, Stefan Knüpfer) aurait plutôt sa place un dimanche soir sur Arte ou Mezzo ? « Réaction élitiste, répondront les distributeurs. Ce document sur le vif, monté comme un thriller, s’adresse à un public beaucoup plus large. » Peut-être. N’empêche que l’essentiel du film porte sur la préparation du piano sur lequel Pierre-Laurent Aimard s’apprête à enregistrer L’Art de la fugue de Bach. Pour un connaisseur, le spectacle du virtuose fou de précision en discussion avec le MacGyver de la corde frappée est aussi savoureux que riche d’enseignements. Mais comme ne l’envoie pas dire Thomas Sotinel dans Le Monde : « Le secret des sons qui sortent d'un piano est minutieusement décrypté sous les yeux des béotiens sans que ceux-ci progressent beaucoup dans leur compréhension du mystère de la musique. » Qu’est-ce qui manque à ce Pianomania pour convaincre tout un chacun que la musique que l’on dit grande ne concerne pas que les professeurs Nimbus de l’accord parfait ? Un peu plus de pédagogie ? Une caméra qui ne regarde pas les artistes et leur drôle d’accordeur comme des oiseaux rares photographiés au téléobjectif ? En attendant, le document est précieux, et tant pis pour la démocratisation.
François Lafon
Pianomania, un film de Lilian Franck et Robert Cibis. En salles depuis le 5 janvier.
Photo ©Jour2fete

- Quelle musique avez-vous écoutée dans votre Porsche ?
- Madonna.
- Son dernier album, Sticky and Sweet ?
- Oui. Je trouve cette femme fascinante, et pas seulement comme musicienne. Elle invente sans cesse, lance des modes, définit des tendances. J’ai très envie de la revoir, et de parler longuement avec elle.
- Elle n’est donc pas seulement un personnage culte, mais aussi une figure culturelle ?
- C’est clair.
- Vous écoutez de la techno et de la house music ?
- Oui.
- Vous connaissez la transe ?
- Non.
- Rythme, rythme, rythme. Extase pure.
- Cela a donc à voir avec le Tristan de Wagner.
Petite énigme de début d’année : l’interviewer est un journaliste du Berliner Morgenpost, mais qui donc est l’interviewé, qui s’extasie sur l’interprète de Like a Virgin tout en faisant référence à Tristan et Isolde ? Réponse : Christian Thielemann, chef d’orchestre à l’ancienne, spécialiste de Bruckner et de Wagner, réputé pour ses opinions conservatrices et sa fascination pour le style démiurgique de Wilhelm Furtwängler et Hans Knappertsbusch. « Je sais que les contraires s’attirent, mais là c’est just silly (stupide, abracadabrant) », commente le journaliste anglais Norman Lebrecht sur son blog Slipped Disc. Aussi opposés que cela, vraiment, la Madone kabbaliste et le maestro tradi ?
François Lafon


