Touchante vision que celle des Bénédictines de l’abbaye Notre-Dame de l’Annonciation de Barroux, dans le Vaucluse, signant à travers les barreaux de leur clôture un contrat d’enregistrement avec Decca, en récompense de leur succès à un concours de chant grégorien féminin auquel ont participé soixante-dix couvents du monde entier. « Au début, nous avons eu peur que cela remette en cause notre vie cloîtrée, explique la Mère supérieure. Nous en avons parlé à Saint Joseph dans nos prières, et elles ont été exaucées ». L’enregistrement s’est, paraît-il, passé normalement, si ce n’est que les techniciens n’ont pas eu le droit de pénétrer dans la chapelle quand les moniales y étaient. Le produit sera 100% bio : de vraies religieuses en prière, et dans leurs murs. De quoi faire de la concurrence aux éternels Bénédictins de Solesmes, et surtout aux très tendance Cisterciens du Stift Heiligenkreuz, en Autriche (plus d’un million d’albums vendus). Art ou prière ? Toujours la même ambiguïté. Peut-on mettre en concurrence l’ensemble Organum de Marcel Pérès et un chœur de clercs en pleine action de grâce ? Quelques (rares) critiques se refusent à le faire. Après tout, si les moines se laissent enregistrer, c’est qu’ils acceptent la règle du jeu. Au public, après cela, d’évaluer le degré de spiritualité dégagée par les uns et les autres.
François Lafon

Foisonnant, le numéro de la revue Books (L’Actualité par les livres du monde) consacré à la musique. En couverture, une kyrielle de mots-clés : répression, rêve, sexe, subversion, transe, violence, joie, amour, beauté, cerveau, drogue, libération, obsession, religion. On y apprend que la musique sert à canaliser la violence, selon la thèse de Jacques Attali dans son livre Bruits (1977, réédité en poche en 2009), qu’elle a joué un rôle primordial dans l’évolution de l’Homo Sapiens, qu’elle est capable d’anticiper les idées du futur, qu’elle peut entraîner des pathologies inquiétantes, mais aussi qu’en dépit de ce qu’en pensent moralistes et cartésiens, elle a peut-être pour seule fonction de procurer du plaisir. On passe en revue ses aspects sociaux et politiques : le negro spiritual et ses dérivés (blues, jazz, rock, rap), la sacralisation des compositeurs au XIXème siècle (Rossini, premier compositeur charismatique), l’engagement des musiciens pendant l’entre-deux guerres, la méfiance des religions vis-à-vis de phénomènes sonores où l’âme et le corps entretiennent de dangereuses accointances. Viennent enfin les phénomènes récents, du disco accompagnant la libération des homosexuels au « rap petit blanc » d’Eminem, pour finir par les diverses utilisations des sons à des fins totalitaires, depuis Staline récupérant Prokofiev jusqu’au hard rock diffusé à tue-tête dans les cellules de Guantanamo. Condition préalable : accepter que la plupart de ces articles véhiculent des références et des schémas de pensée typiquement américains. Les mêmes sujets, traités par des Européens, pourraient nous entraîner sur des chemins bien différents. Qui s’y colle ?
François Lafon
Le Pouvoir de la musique. Books, n° 14, juillet-août 2010. 5,90 euros.

Acclamations dans la presse, tohu-bohu sur Internet : l’organiste Jean Guillou refuse la Légion d’honneur. On cite ses prédécesseurs (Littré, Sartre et Beauvoir, les époux Curie, mais aussi Geneviève de Fontenay, Brigitte Bardot et Léo Ferré), on rappelle quelques bons mots (Satie : « Ravel refuse la Légion d’honneur, mais toute sa musique l’accepte »). Guillou, qui ne se sent pas prophète en son pays (la liste de ses pairs en la matière serait, elle aussi, très longue) et entretient sa réputation de mauvais coucheur, en profite pour rappeler qu’il attend toujours un financement pour la construction de son orgue à structure variable (OSV), doté de quinze buffets amovibles, tout en déplorant la place de moins en moins grande accordée aux musiciens classiques, à l’heure où la Villa Médicis elle-même préfère accueillir des artistes commerciaux plutôt que des chercheurs. Bref, l’organiste de Saint Eustache prend la relève de Laurent Terzieff quant à l’éthique du métier d’artiste. Mais Terzieff, qui répondait « Personne ne me doit rien, alors je prends ce qu’on me donne » à qui s’étonnait de la maigreur des subventions allouées à sa Compagnie, avait accepté, lui, d’être Officier de l’Ordre National du Mérite et Commandeur des Arts et Lettres. Il avait dû méditer un autre bon mot de Satie, colporté par Jean Cocteau : « Il ne suffit pas de refuser la Légion d’honneur, encore faut-il ne l’avoir pas méritée ».
François Lafon

Il n’y a pas que sur L’Elysée que souffle la tempête. Mardi 6 juillet, Stéphane Lissner, surintendant de la Scala de Milan, convoque la presse : « Si le secrétaire d’état à la culture Sandro Bondi ne fait rien, nous allons devoir fermer boutique. » L’illustre vaisseau n’est pas le seul à tanguer. Suite à un décret visant à endiguer le déficit chronique dont ils sont atteints (voir L’Italie malade de ses opéras), tous les théâtres italiens réduisent la voilure, entraînant grèves, annulation de spectacles, règlements de compte en cascade. Mais la Scala est un théâtre à part, et Monsieur Lissner (en français dans le texte), acclamé à son arrivée, n’a plus bonne presse. Fidèle à lui-même, et probablement agacé par le renvoi du chef français Jean-Christophe Spinosi - qui devait diriger Le Barbier de Séville - pour « incapacité à instaurer des relations de travail sereines et constructives », l’ancien directeur du Châtelet et du festival d’Aix n’épargne personne, si ce n’est les syndicats, craignant probablement - selon le blog italo-américain Opera chic - que ceux-ci ne fassent capoter la tournée en Argentine de l’orchestre et du chœur, prévue cet été. Il est même parti en guerre contre ses confrères de Vienne et de Munich, lesquels programment, à son avis, des « spectacles de bas étage. » Ioan Holander, directeur sortant du Staatsoper de Vienne, parle dans le Frankfurter Roundschau d’une « attaque sans précédent de la part d’un confrère », et ajoute qu’il est « très difficile d’engager une discussion avec quelqu’un qui ne sait même pas lire la musique. » « Je comprends, assène-t-il en guise de coup de grâce, que Monsieur Lissner ait besoin de détourner l’attention de la presse italienne de ce qui se passe – ou plutôt ne se passe pas – à La Scala. En ce moment, nous avons à Vienne Christian Thielemann, Seiji Ozawa, Riccardo Muti et Zubin Mehta. Ils ne sont pas à la Scala, où il n’y a que Monsieur Lissner, ce qui n’est pas gai. » L’histoire ne dit pas ce qu’en pense un autre Français, Dominique Meier – jusqu’à cette année directeur du Théâtre des Champs-Elysées –, qui s’apprête à succéder à Ioan Holander à la tête de l’Opéra de Vienne. En attendant, la rumeur se répand que Lissner aurait convaincu Pierre Boulez de composer son premier opéra : une adaptation d’En attendant Godot de Samuel Beckett. Création prévue en 2015 … à la Scala.
François Lafon
Si les mises en scène de Christoph Marthaler vous dépriment, si vous ne vous êtes pas remis de Tristan et Isolde à fond de cale (Bayreuth), de Kata Kabanova dans l’arrière-cour (Salzbourg), de La Traviata à la MJC (Paris), regardez sur Arte + 7 Papperlapapp, le « babillage en papauté » imaginé par Marthaler pour le festival d’Avignon, dont il est cette année l’invité d’honneur. Cette animation de la cour du Palais de Papes en forme de patchwork géant, cette réflexion in loco sur l’état actuel du théâtre et du sacré, ponctuée de musiques artistement choisies, peut être utilisé comme un mode d’emploi de Marthaler metteur en scène d’opéra. Il y a un moment où le groupe de touristes qui investit ce saint lieu se recueille devant un caddy de ménagère, avant d’être dispersé par une sonnerie d’alarme. Or qu’y-a-t-il dans ce caddy suspect ? Une baguette de pain, qu’un des assistants va briser et manger sur un autel jouxtant une énorme machine à laver, tandis que résonne le leimotiv du Graal de Parsifal. Si le symbole vous laisse froid, vous n’êtes décidément pas prêt à embrasser la foi marthalérienne. A moins que votre résistance ne soit le premier signe de votre conversion.
François Lafon

Opéra de Paris (direction : Rolf Liebermann), années 1970 :
-Qui dirige Les Noces de Figaro ce soir et Le Trouvère demain ?
-Charles Mackerras.
-Comme d’habitude.
English National Opera (Londres), même époque :
-Qui dirige Jules César avec Janet Baker ce soir ?
-Sir Charles Mackerras.
-Ah, très bien.
Rudolfinium (Prague), années 1980 :
-Qui dirige la 8ème de Dvorak avec le Philharmonique ce soir ?
-Charles Mackerras.
-La tradition.
N’importe où dans le monde (musical), 1983 :
-Jenufa vient de paraître chez Decca
-Par Mackerras, avec Elisabeth Söderström ?
-Oui. Je l’ai déjà acheté.
Londres, 14 juillet 2010 :
-Sir Charles est mort
-Mais il était jeune.
-Il était né en 1925, comme Pierre Boulez.
Trois axes : Mozart et Handel, la musique tchèque, et puis un énorme répertoire, tant symphonique que lyrique. Américain de naissance, Australien de formation, pur produit de l’establishment musical anglais d’après-guerre, mais aussi élève à Prague du grand chef Vaclav Talich, Charles Mackerras n’a pas été un chef au charisme ravageur, mais sans lui, les baroqueux auraient mis plus de temps à découvrir Handel, les mozartiens à déromantiser Mozart, les programmateurs à comprendre que Janacek fait partie du top ten des génies du lyrique (et de la musique tout court). Il laisse beaucoup de disques. Le Messie de Handel (Archiv), tous ses Janacek (Decca, Supraphon), sans oublier la série de Concertos pour piano de Mozart avec Alfred Brendel (Philips) sont à mettre entre toutes les oreilles. Les fans n’oublieront ni son Jules César (in english, avec Janet Baker – EMI), ni son récent Cosi fan tutte (Chandos), in english aussi, mais dirigé avec un chic sans égal.
François Lafon
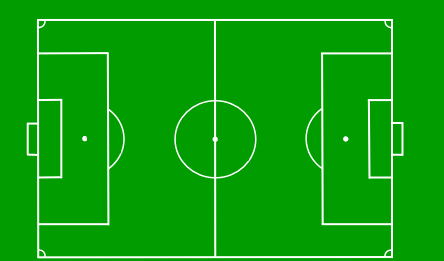
Les fanfares de vuvuzelas vous ont peut-être empêché de les entendre, mais la Coupe du Monde de football a été une bonne occasion de faire le tour des hymnes nationaux. Dès la cérémonie d’ouverture, joueurs noirs et blancs ont entonné en choeur le Nkosi Sikelel' iAfrika, un hymne rassembleur mélangeant le chant des colonisateurs et celui des anti-apartheid. Plus classiques, les Allemands nous ont gratifiés de la belle mélodie de Joseph Haydn composée à l'origine pour l'Empereur d'Autriche, et les Anglais du God save the Queen. Très en vue, avant de se faire éliminer par les équipes européennes, les sud-américains ont apparemment été inspirées par l'ardeur de leurs hymnes. Avec leurs introductions enlevées et leurs refrains martiaux, ceux de l'Argentine, du Chili, de l'Uruguay ou du Brésil font penser à un air de Rossini ou à un choeur du jeune Verdi. Ce n'est pas un hasard : ces pays ont gagné leur indépendance au début du XIXè siècle, à l'époque où l'opéra italien était un modèle des deux côtés de l'Atlantique. Ils sont aujourd'hui datés, dans le meilleur sens du terme : 1813 (Argentine), 1822 (Brésil), 1827 (Chili, oeuvre d'un Catalan), 1845 (Uruguay, écrit par un Hongrois), 1854 (Mexique, composé encore par un Catalan).
Quant à l'Espagne, qui a gagné la Coupe, elle a de la chance avec sa Marche royale du XVIIIè siècle : comme elle est sans paroles, les footballeurs ne sont pas obligés de le chanter, ce qui est plutôt un avantage dans un pays aux fortes identités régionales. Les Hollandais, eux, ont chanté leur défaite avant même de débuter la finale. Dans leur hymne, le « Het Wilhelmus », on entend : « Que les Espagnols te meurtrissent/ ô loyaux et doux Pays-Bas, /lorsque j'y pense, /mon noble coeur en saigne. »
Pablo Galonce

De quoi est mort Beethoven ? De la syphilis, ou d’une cirrhose du foie, a-t-on longtemps dit. Plus récemment, on a évoqué la maladie de Crohn. « Pas du tout, rétorquent des chercheurs américains, après s’être penchés sur des cheveux et un fragment de boîte crânienne. Beethoven est mort de saturnisme, c'est-à-dire d’une longue intoxication au plomb ». Cela expliquerait mieux encore ses douleurs abdominales, ses troubles digestifs, sa bronchite chronique, sa mauvaise haleine, ses sautes d’humeur et ses défaillances de mémoire. Cet excès de plomb viendrait, entre autres, du vin à bon marché que Ludwig van consommait à outrance, et auquel on ajoutait du plomb pour en atténuer l’amertume. Mais voilà que le Dr. Andrew C. Todd, expert de l’école de médecine Mount Sinai, à New York, conteste cette explication, après avoir analysé les fragments déjà cités, auxquels il a ajouté un autre morceau de crâne, plus gros. « Beethoven n’a pas davantage été exposé au plomb que n’importe quel humain âgé de cinquante-six ans », affirme-t-il. Le problème, rétorque le Dr. William R. Meredith, professeur à l’Université de San Jose (Californie) et directeur du Ira F. Brilliant Center for Beethoven Studies, c’est que le plus petit fragment de crâne contient quarante-huit microgrammes de plomb par gramme, alors que le plus petit n’en contient que treize ». De son côté le Dr. William Walsh, de l’Argonne National Laboratory, en Illinois, fait remarquer que son collègue le Dr. Todd n’a travaillé que sur les morceaux de crâne, en oubliant les cheveux, mais tombe d’accord avec lui sur le fait que l’exposition au plomb ne daterait que de la fin de la vie de Beethoven. Et pourtant l’irritabilité, la faiblesse musculaire, les migraines et la fatigue récurrente sont les symptômes types de ce genre d’affection. Alors ? Edmund Morris, dans son livre Beethoven, le compositeur universel (Harper Collins – 2005), note que l’année de sa mort, l’auteur de Fidelio avait suivi un traitement à base de jus de fruit, et qu’il préférait bien sûr les jus fermentés. Résultat : diarrhées et alcoolisme prononcé. Bon. D’autres encore évoquent une déficience cardiaque, ou la maladie de peau appelée lupus. Bref, la mort de Beethoven n’est pas moins problématique que celle de Mozart ou de Napoléon. A propos, que font ses restes aux Etats-Unis ? Ils proviennent d’une boite de métal contenant treize fragments humains, sur laquelle est écrit « Beethoven », et qu’un homme d’affaires californien a héritée de son grand-oncle. D’ici qu’on découvre que ce Beethoven-là n’est pas le bon…
François Lafon

Dans l’opéra-crossover de Rufus Wainwright Prima Donna, créé l’année dernière au festival de Manchester, la diva est française et s’appelle Régine Saint-Laurent : double symbole, relayé aujourd’hui par une exposition Régine Crespin au Palais Garnier. Bel exemple de repentance à la française : « Paris a été ingrat à l’égard de la seule grande voix hexagonale de l’après-guerre », clame sans relâche le lyricographe André Tubeuf, âme de l’exposition et préfacier du somptueux livre de photos qui fait office de catalogue. Les photos parlent d’elles-mêmes : Régine à l’accent ensoleillé et Crespin la diva chinchilla, la débutante aux rôles (trop ?) lourds et la coqueluche de Bayreuth et du MET, la prof de chant coiffée d’un turban et la Crespinette goualant chez Guy Lux. Sur place, à Garnier, les reliques : manuscrits, contrats, partitions annotées, médailles, programmes, pour la plupart conservés à la Bibliothèque-Musée de l’Opéra. Tout un monde déjà lointain, un âge dur qu’on se plait à voir aujourd’hui comme un âge d’or. Un pendant - n’en déplaise aux gardiens du temple - à l’exposition Dalida à l’Hôtel de Ville.
François Lafon
Exposition Régine Crespin. Palais Garnier, angle rue Scribe et Auber, Paris 75009. Jusqu’au 15 août.
Hommage à Régine Crespin, sous la direction de Christophe Ghristi. Contributions d’Hubert Nyssen et André Tubeuf. Actes Sud/Opéra National de Paris, 136 pages, 29 euros
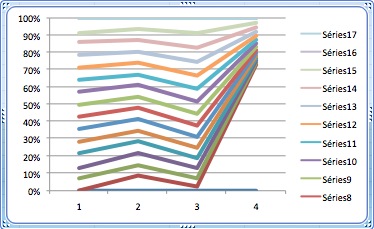
Dans l’éditorial qu’il signe sur le site Concertclassic.com, Jacques Doucelin traite « Du bon usage de la crise ». Il constate que les salles sont pleines et que les festivals pullulent, mais rappelle que les caisses sont vides, que la France est le pays d’Europe où la culture est le plus généreusement subventionnée et que le spectacle vivant est désormais noyé dans des structures géantes appelées Création ou Patrimoine, ce qui « rend la lecture des lignes budgétaires quasi impossible ». Comme d’habitude, les gros (Opéra de Paris, Comédie-Française) sont à l’abri, tandis que les petits tremblent. Soit. Mais comme il vaut mieux être optimiste que pessimiste, l’ancien chroniqueur musical du Figaro enchaîne sur les avantages de la rigueur. Il se demande si les subventions allouées aux « fêtes de village pompeusement baptisées festivals » sont nécessaires, et se félicite de ce que les directeurs de théâtres vont devoir mettre leur ego sous le boisseau et multiplier les coproductions avec leurs rivaux et néanmoins amis. Soit encore. C’est alors qu’il abat ses cartes. « Le mouvement baroque s’est développé sans aucune subvention : c’est en effet par sa seule qualité qu’il a imposé ses choix esthétiques au public d’abord, aux tutelles administratives ensuite », rappelle-t-il, mentionnant au passage le centre culturel 104, rue d’Aubervilliers à Paris, que l’on a vu « faire naufrage par péché d’orgueil », et finissant par citer Maurice Druon déclarant, du temps où il était ministre de la Culture, que « nul n’est obligé de tendre la sébile ». Revoilà la question cruciale, ou plutôt bilatérale (droite contre gauche) : le talent a-t-il besoin d’être aidé ? Comme le libéralisme a en ce moment mauvaise presse (il y a des raisons pour cela), Doucelin glisse une référence œcuménique : « Puisse-t-on ne pas oublier l’exemple plus d’actualité que jamais du Théâtre National Populaire, celui de Jean Vilar et de Jeanne Laurent : tout était fait pour la satisfaction du public. Qui dit argent public dit service du public. La culture n’est pas une exception ». Ouf ! Mais il nous renvoie à la case départ : entre service public et service du public, il n’y a plus qu’une histoire de gros sous, et ce « public » représenté à l’époque de Vilar par les « privilégiés populaires » fréquentant le TNP n’est plus cernable aujourd’hui qu’en termes de parts de marché.
François Lafon
Diffusion en direct sur Arte de Don Giovanni depuis le festival d’Aix. Mise en scène du jeune Dimitri Tcherniakov, lancé par un Eugène Onéguine formidable importé du Bolchoï au Palais Garnier, il y a deux ans. Cette fois, le titre est grand public, mais le spectacle ne l’est pas. En prélude, un générique projeté sur le rideau : Zerline n’est plus une paysanne mais la fille de Donna Anna, Donna Elvira sa cousine, et le valet Leporello est promu parent (pauvre ?) du Commandeur. Exeunt les différences de classe (les maîtres, le valet, les paysans) qui structurent l’intrigue. Tout se passe dans un salon cossu, où les personnages vont se laisser aller comme on ne le fait pas… dans un salon cossu. C’est du pur Regietheater, une sorte de palimpseste sans scrupules, présupposant de la part du spectateur qui veut bien se prêter au jeu une parfaite connaissance de l’ouvrage. L’amateur éclairé comprendra à la fin que nous ne sommes plus chez Mozart mais chez Agatha Christie, et que, comme dans Le Crime de l’Orient-Express, le complot contre le transgresseur était ourdi de longue date. Comme Tcherniakov est malin, il retombe sur ses pieds, mais au prix de quelles acrobaties ! Lui qui ne voulait pas que les gens viennent voir « son » Don Giovanni pour entendre de la belle musique chantée par de belles voix, il doit n’être qu’à moitié satisfait : les voix sont ordinaires, mais la musique est d’autant plus belle que le chef Louis Langrée dirige avec finesse le Freiburger Barockorchester. Il y a des huées dans la salle, que les preneurs de son ne peuvent masquer. Le Rossignol de Stravinsky, pertinemment mis en scène par Robert Lepage au même festival d’Aix, aurait été plus accessible au commun des mortels. Mais Stravinsky en presque prime time, même sur Arte, ça ne doit pas le faire.
François Lafon
Don Giovanni, festival d’Aix en Provence, Théâtre de l’Archevêché, les 9, 12, 14, 16, 18, 20 juillet. Sur Internet : Arte + 7

C’est l’histoire d’un pianiste sur le retour qui donne des leçons pour vivre et qui déteste ses élèves, d’un monsieur qui ne peut pas jouer de fa dièse parce que son épouse est morte pendant un fa dièse (et une partie de mikado), d’une dame qui vit un enfer par amour pour Chopin, d’un duo de clarinettistes qui se battent pour jouer en solo, d’un ado allergique au piano et qui joue Purcell à la trompette (et non à la vuvuzela) pendant les matchs de foot. C’est le portrait, en une dizaine de chapitres placés chacun sous le signe d’une œuvre célèbre, de quelques-uns de ces malades (dont nous sommes, vous et moi) qui peuplent l’univers enchanté et vermoulu de la musique classique. C’est signé Christian Binet, le papa des immortels Bidochon, lui-même mélomane, instrumentiste et compositeur, et faisant donc partie, lui aussi, des malades en question. C’est drôle, méchant et pertinent. Extrait du dialogue :
- Voyez-vous Maestro, quand je joue cette sonate, je revois le visage de Madeleine !!
- Si seulement vous pouviez voir la tête de Mozart !!
Cela est intitulé Bas de gamme, et c’est le premier volume d’une série appelée Haut de gamme. C’est une bande dessinée, bien sûr, où l’on retrouve le trait sale et précis en même temps, les personnages pas beaux mais très vrais qui ont fait la réputation de l’auteur. Miroir, mon beau miroir…
François Lafon
Binet : Haut de gamme. Vol. 1 : Bas de gamme. Dargaud, 47 pages, 9,95 euros


