Un jeune homme se lève. Au pied du lit, un i-phone. Le jeune homme pose les pieds par terre : tap, tap. Il frappe dans ses mains : clac, clac. Dans la salle de bains, il allume son rasoir électrique : tse-tse-tse-tse. Petit déjeuner, il fait frire un œuf - splehhh,- et actionne le grille-pain : tic, tac. Il prend sa guitare, et essaye une mélodie. Il sort, croise une fille jouant du violon : mélodie encore, plus accompagnement i-phone : tap, clac, tse, spleeh, tic. Il prend le bus : silence pour nous, tse, spleeh, tic dans les écouteurs. Il entre dans un studio, une chanteuse chante, l’i-phone sur le micro : tap, clac, etc. Le jeune homme est le héros d’autres vidéos, dont l’une se passe dans un parc et invente un nouveau rythme, le Duckstep (pas du canard). Celle-ci, intitulée Everything is an instrument, est une publicité pour une application i-phone destinée aux i-compositeurs en i-herbe. Capter les rythmes de la vie moderne, faire musique de tout : on pense aux ancêtres, Pierre Henry, Mauricio Kagel. La musique du jeune homme n’aurait pas eu sa place dans les festivals d’avant-garde des années 1970, mais le principe est le même.
François Lafon
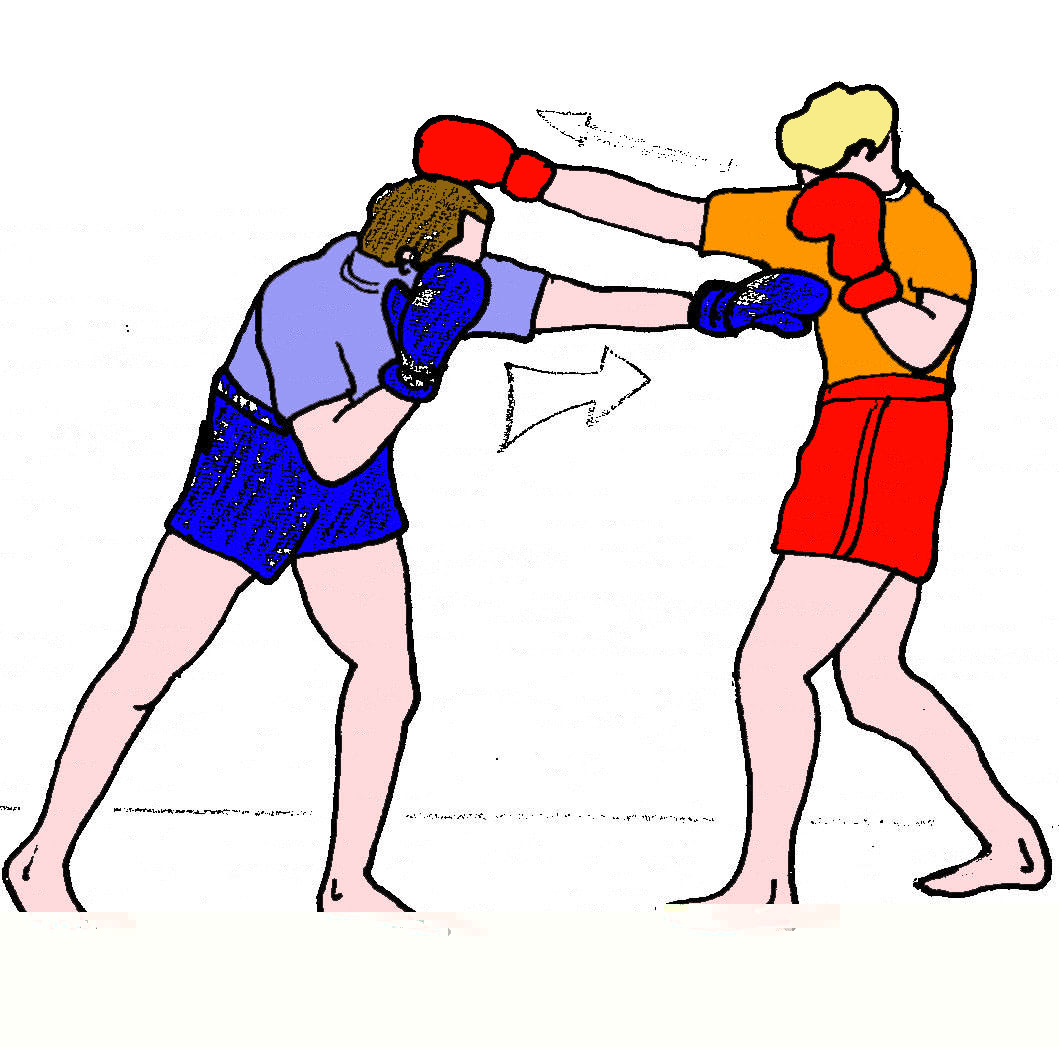
Au festival de La Roque-d’Anthéron, une jeune pianiste chinoise joue Chopin, Brahms, Scarlatti et Stravinsky. Sur son blog, l’éminent critique Frédéric Ballade s’extasie. Sur le sien, son élève Léo Poldowski persifle. « Plus tard, le récital fini, il sera toujours temps de nous demander qui nous fait un tel don, et si nous n’avons pas rêvé », écrit le premier. « Mlle Jin imite parfaitement, mais elle imite. Avant même qu’elle tente de s’en approcher, Chopin s’éloigne d’elle. C’est normal. C’est irrémédiable », répond le second. S’ensuit un duel à mort, public (blogs) et privé (e-mails), où se mêlent griefs personnels et positions esthétiques. Ce sont ces dernières qui font l’intérêt de Piano chinois, petit roman e-épistolaire du romancier, essayiste et … critique suisse Etienne Barilier. Périodes élégiaques et formules qui font mal, papiers d’humeur et analyses de fond, avalanche de références (Rubinstein, Haskil, Richter à la rescousse) et sèches affirmations, racisme latent (une Chinoise ne peut pas comprendre la musique occidentale) et déni des différences culturelles : la critique en prend pour son grade, et chacun y reconnaîtra les siens. On aimerait que tout cela soit plus léger, que les adversaires soient moins pédants, que leur plume soit moins lourde, qu’ils jouent moins à Trissotin et Vadius. Mais cela, c’est peut-être une réaction de critique, et la preuve que la flèche atteint son but.
François Lafon
Piano chinois, Duel autour d’un récital d’Etienne Barilier. Editions Zoé. 133 p., 16 euros.

Au programme de l’Orchestre de Paris cette semaine : La Barque solaire, pour orgue et orchestre, de Thierry Escaich, la 3ème Symphonie « avec orgue » de Saint-Saëns et le Concerto pour violoncelle de Dvorak. Paavo Järvi est au pupitre, Escaich lui-même à l’orgue et Gautier Capuçon au violoncelle. Le clavier d’Escaich est installé côté jardin. De part et d’autre du plateau : de grandes enceintes. La Barque solaire, inspiré du Livre des Morts Egyptien, place l’orgue, aux harmonies d’éternité, au centre d’un orchestre déchaîné. Des sonorités faibles et étouffées : ce n’est pas un concerto pour orgue, précise le compositeur. Soit. Dans la Symphonie de Saint-Saëns, l’orgue est là aussi pour soutenir, mais il éclate, au début du Finale, en un péremptoire do majeur. Même discrétion. Avant l’entracte, Capuçon, très applaudi (à juste titre) dans Dvorak, appelle Escaich pour un bis kitsch et délicieux : « Mon cœur s’ouvre à ta voix » (Saint-Saëns, Samson et Dalila) transcrit pour violoncelle et orgue. Egale frustration. Le grand Cavaillé-Coll de Pleyel, inauguré en 1929 par Marcel Dupré, n’est qu’un lointain souvenir. Aujourd’hui, on se passe, quand on construit ou rénove une salle, de ce genre de monument, onéreux, archaïque et encombrant. Hier soir, on l’a quand même un peu regretté.
François Lafon
Salle Pleyel, Paris, 18 et 19 mai.

Réédition chez Actes Sud de La Visite de Wagner à Rossini, d’Edmond Michotte. Un scoop du XIXème siècle, un rêve de journaliste. Trop beau pour être vrai ? Peut-être. Compositeur, amateur d’art, ami des puissants et détecteur de talents, ce Michotte que la postérité n’a pas retenue n’a publié qu’en 1906 la retranscription de cet entretien choc qu’il avait organisé en … 1860. Le texte est trop beau lui aussi. Après avoir épépiné la conjoncture culturelle du temps, l’illustre Italien retiré à Paris et le Saxon venu y chercher une reconnaissance qu’il ne trouvera pas exposent leurs théories, et parlent comme un livre. « J’affirme qu’il est logiquement inévitable que, par une évolution toute naturelle, lente, peut-être, naîtra non pas cette musique de l’avenir que l’on s’obstine à m’attribuer la prétention de vouloir engendrer tout seul, mais l’avenir du drame musical », déclare le second, auquel le premier répond « Au point de vue de l’art pur, ce sont là sans doute des vues larges, des perspectives séduisantes. Mais au point de vue de la forme musicale en particulier, c’est l’oraison funèbre de la mélodie ». La mise en scène n’est pas moins raffinée. « Ah ! Monsieur Wagner, comme un nouvel Orphée, vous ne craignez pas de franchir ce seuil redoutable ? », demande Rossini à celui qu’il est censé détester, et dont il dira, une fois l’entretien terminé « Tout son physique, son menton surtout, révèle le tempérament d’une volonté de fer. C’est une grande chose que de savoir vouloir. S’il possède au même degré, comme je le crois, le don de pouvoir, il fera parler de lui ». Grand moment : Rossini racontant à Wagner sa visite à Beethoven. « Surtout, faites beaucoup del Barbiere », dit le génie au jeune surdoué. C’était en 1822, Michotte n’était pas né. Dommage, il aurait très bien raconté cela.
François Lafon
Edmond Michotte : La Visite de Wagner à Rossini. Préface de Xavier Lacavalerie. Actes Sud, 105 p., 15 euros. Photos © DR

Le motet de Thomas Tallis Spem in alium, avec ses quarante voix réelles, a longtemps été considéré comme le parangon de la complexité en musique. Or voilà que sur le modèle du dessin animé de Tex Avery Le plus petit Pygmée du monde - interdit au nom du politiquement correct -, le claveciniste Davitt Moroney a retrouvé à la Bibliothèque Nationale, où elle se cachait sous une étiquette erronée, une pièce plus ancienne et plus étonnante encore signée Alessandro Striggio (père du librettiste de Monteverdi), la Missa supra ecco si beato giorno, elle aussi à quarante voix (soixante, même, pour l’Agnus Dei final). Ledit Striggio était d’ailleurs coutumier du fait, puisqu’il s’était auparavant fait la main sur un motet, Ecce Beatam Lucem, pour quarante voix indépendantes. C’est en réaction à ces folies sonores qu’a fleuri la monodie accompagnée, matériau de base de l’opéra. De quoi faire réfléchir les derniers tenants du parallélisme complexité grandissante = progrès, encore étonnés qu’à l’avant-garde dure des années 1950-1980 soient venus s’opposer des courants « néo » réhabilitant un confort musical bassement bourgeois. Alessandro Striggio – Bernd Alois Zimmermann, même combat ? Les Soldats de Zimmermann, une des partitions les plus complexes du XXème siècle, étant un opéra, les tenants du parallélisme précité réfléchiront aussi sur le fait que, bien loin de suivre le chemin sans retour de l’évolution de l’espèce (musicale), la création n’en finit pas de tourner en rond.
François Lafon
Alessandro Striggio : Messe à quarante voix. I Fagliolini, Robert Hollingworth (direction) – 1 CD Decca. Sortie le 6 juin.

Jane Rhodes à Mirella Freni pendant l’enregistrement de Mireille, à Toulouse en 1979 : « Chanter Taven la sorcière, c’est un défi pour moi, le comble du rôle de composition. » Deux ans auparavant, au festival d’Aix, elle avait alterné avec Janet Baker dans Didon et Enée de Purcell. Applaudissements polis, comme si le public lui reprochait d’usurper la place de la grande Baker. En 1959, Jane Rhodes avait fait la une des quotidiens : avec son futur mari Roberto Benzi, ex-enfant prodige de la direction, elle était Carmen à l’Opéra dans la mise en scène de Raymond Rouleau décorée par Lila de Nobili : première de l’ouvrage au Palais Garnier (avant, on le donnait à l’Opéra Comique), première captation télévisée (les actes 1 et 4 seulement, les autres étant trop peu éclairés). Jane Rhodes aura symbolisé une certaine tradition du chant français, dont on commençait à ne plus vouloir, tout en préparant un renouveau qui est arrivé trop tard pour elle. Un souvenir : la reprise de La Damnation de Faust dans la mise en scène de Maurice Béjart au Palais des Sports de la porte de Versailles. Jane Rhodes traversant l’arène, après un « D’Amour l’ardente flamme » d’anthologie. Acclamations d’un public venu surtout pour Béjart. Jane Rhodes, disparue le 7 mai, avait une voix riche – mezzo et soprano à la fois – et du charisme à revendre.
François Lafon
Photo DR
Une table lumineuse, sur laquelle est dessinée une portée. Deux enceintes sur pieds. Une clé de sol, des noires et des croches en bois, d’une vingtaine de centimètre de hauteur. Posez une noire entre les deux lignes du bas de la portée : un fa se fait entendre, tandis que le nom de la note s’affiche en-dessous. Alignez plusieurs notes, et appuyez sur un bouton placé à gauche de la table : la mélodie que vous venez de composer résonne à vos oreilles. Le timbre de base est celui du piano, mais il suffit d’actionner un autre bouton pour entendre un vibraphone, ou une guitare. Pourquoi ces objets encombrants, alors que vous pouvez obtenir le même résultat sur votre écran ? Parce que, justement, la manipulation des notes en bois (et non en plastique), leur poids, différent selon leur durée, font partie du traitement. Il s’agit, en fait, de se désintoxiquer du côté virtuel de l’ordinateur. « Même si un piano est un instrument de musique relativement simple à utiliser, il ne vous apprendra pas à lire ni à composer une partition », dit la publicité. Bien d’accord : on peut jouer Au Clair de la lune avec un doigt, mais pas réviser son solfège rien qu’en regardant le clavier. Le titre de l’article de présentation sur Gizmondo est plus étrange : «La table surface que Beethoven aurait pu concevoir ». Parce qu’il était sourd ? Dans le petit film de démonstration, les notes jouées par la table sont accompagnées par un long accord électronique. D’où vient-il ? De la table, ou d’un ordinateur ? A quoi sert-il ? A nous faire croire qu’un Steve Reich ou un John Adams sommeille en chacun de nous ? Que ne ferait-on pas pour adoucir le dur apprentissage de la musique ! Seul élément mystérieux : le prix de ce prodige de technologie.
François Lafon
Table Noteput, conçue par Jürgen Graef et Jonas Heue.


