
Les Mémoires intimes de Gabriel Dussurget : on en sourit d’avance. Le créateur du festival d’Aix-en-Provence a été un des derniers acteurs de ce monde où l’art n’était pas encore de la culture, où les réputations se faisaient dans les salons, où les mécènes n’avaient pas encore cédé la place aux sponsors. Il était célèbre pour ses bons mots (« J’ai la frivolité sérieuse ») et ses réparties acerbes (« Jolie voix, mais dans l’aigu, cela devient grave » ; « Voilà un artiste qui ne commet pas une faute de mauvais goût », etc.), que colportait une société où tout était permis pourvu que l’on ne commette pas, justement, de faute de goût. Or ces Mémoires inachevés, qui ont attendu quinze ans avant que sa petite nièce ne les édite, secondée par le journaliste Renaud Machart, n’ont rien de particulièrement drôle. On y retrouve la patte Dussurget, qui frappe en douceur à l’endroit le plus sensible, et l’on reste songeur devant ce dilettante qui a soulevé des montagnes (Aix, bien sûr, mais aussi un grand bureau de concerts, l’Opéra de Paris et le Ballet des Champs-Elysées), cet homme du monde décrivant avec un mélange d’innocence et de cruauté la vie des homosexuels fortunés dans une Europe qui ne connaissait pas encore la Gay Pride. Sur la couverture : un portrait de Dussurget jeune par le graphiste Cassandre. L’œil est sans illusion, le menton volontaire. C’est ce regard que l’on sent tout au long des ces pages, un peu glacé, un peu distant, et pourtant bienveillant. Comme un antidote aux ravages de l’actuelle bien-pensance.
François Lafon
Gabriel Dussurget, le magicien d’Aix. Mémoires intimes. Actes Sud, 256 p., 21€

Exposition au Palais Garnier : Les Tragédiennes de l’Opéra, 1875-1939. Tout est dans les dates. Passée la guerre, le cinéma a définitivement pris le pas sur la scène dans l’imaginaire populaire. Finis les monstres sacrées, les Sarah Bernhardt au théâtre, les Rose Caron à l’opéra. Il y aura des bêtes de scène tourmentées - Maria Callas - Maria Casarès -, puis on passera aux divas-tragédiennes à taille humaine. Au premier abord, l’exposition est réservée aux nostalgiques. Ces photos, superbement mises en scène, de Lucienne Bréval, de Blanche Deschamps-Jehin, d’Agnès Borgo, de Geneviève Vix, de Suzanne Blaguerie, ne disent plus grand-chose. Les codes de l’érotisme ont changé, et ces dames aux formes généreuses, aux poses étudiées, au regard souligné de fard prêtent à sourire. « Mais peut-on encore les entendre ? » demande Edouard Balladur invité au vernissage. Là est le problème : certaines de ces dames ont, dès le début du XXème siècle, essuyé les plâtres des studios d’enregistrement, mais les témoignages qu’elles ont laissé s’adressent à des oreilles expertes. Plus près de nous, on connaît, même dénaturée par le micro, la voix de Germaine Lubin, mais celle de Fanny Heldy est déjà plus difficile à apprécier. Quant à celle de Marcelle Demougeot, en 1904 dans Le Trouvère de Verdi … Des maquettes de décors, des bijoux - splendides pacotilles plus vraies que les vrais -, en disent beaucoup sur cet art de la grandeur de théâtre, et restituent cette époque où un port de bras, une expression douloureuse perpétuaient toute une tradition, dont le cinéma muet fera son miel. Le catalogue, magnifique (et assez onéreux : 49 €) est un bon sésame : textes d’introduction (La Diva et le directeur d’opéra, Muse et tragédiennes), portraits documentés et non dénués d’humour, signée, entre autres, André Tubeuf ou Pierre Vidal. Entre Mireille Berthon et Fanny Heldy, on trouve Françoise Rosay, voix météorique connue pour avoir remporté un certain succès en Thaïs au lendemain de la première guerre mondiale. On imagine le commentaire que cette dernière, une fois devenue la vedette de l’écran que l’on connaît, aurait fait sur tout cela, de sa voix rocailleuse et délicieusement faubourienne.
François Lafon
Au Palais Garnier, Bibliothèque-musée, jusqu’au 16 juillet, et du 10 au 25 septembre. Catalogue Les Tragédiennes de l’Opéra, Albin Michel, 289 p., 49 €

Procédant à son grand ménage de printemps, une dame anglaise se débarrasse d’un lot de vieilles partitions auprès de l’association humanitaire Oxfram. Or voilà que la bénévole chargée du tri y découvre une seconde édition, rarissime, des six Sonates pour clavecin composées à Londres par le jeune Mozart (huit ans) et dédiées à « Sa Majesté Marie-Charlotte, Reine de Grande-Bretagne » (en français dans le texte). Elle alerte la prestigieuse société Sotheby’s, qui organise immédiatement une vente aux enchères. Appel affolé de la donatrice, affirmant que la précieuse partition s’était glissée par erreur dans le lot en question. La vente est annulée, et Oxfram s’engage à lui rendre la partition, à condition qu’elle prouve qu’elle en est bien la propriétaire. Moralité : aider les pauvres, c’est bien, mais il ne faut quand même pas leur donner des goûts de luxe.
François Lafon
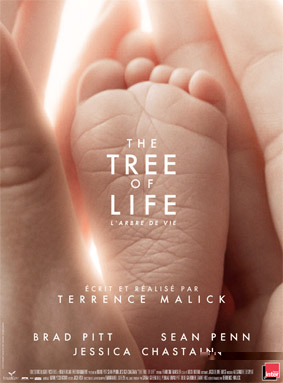
Une mère apprend par un télégramme la mort d’un de ses fils ; tandis que la caméra suit ce visage défait par la douleur, on entend des notes harmoniques suspendues des cordes et des étranges intervalles des bois : c’est le début de la Première symphonie de Mahler. Ainsi commence The Tree of Life, nouvel opus de Terrence Malick et Palme d’Or du dernier Festival de Cannes.
Du Big Bang (merci Kubrick) aux gratte-ciels en passant par les premières cellules et les dinosaures (merci Spielberg), le cinéaste fait un tour de plusieurs milliards d’années dans l’univers entier pour s’intéresser finalement à un seul enfant élevé dans l’Amérique idyllique des années 1950 où l’on vit dans un éternel coucher de soleil d’été. La bande son de ce Kindertotenlieder panthéiste et mystique au message très simple (« aimez-vous ») ravira plutôt les amateurs de sensations planantes, tellement Malick abuse des pages pour chœur et orchestre à tendance néotonal : Giya Kancheli, Zbigniew Preisner, John Tavener, Henryk Górecki donnent le ton du film plus encore que les bribes de musique originale composée par Alexandre Desplat. Mais on entend aussi Smetana (la Moldau pour illustrer la joie des jeux d’enfants), Couperin, Holst et à nouveau la Première symphonie de Mahler pour accompagner la mort d’un autre enfant.
Il y a même la Toccata et fugue en ré mineur de Bach, jouée à l’orgue par Brad Pitt, père autoritaire, musicien raté plein d’amertume et admirateur de Toscanini au point de faire écouter à sa famille pendant le dîner l’enregistrement de la Quatrième symphonie de Brahms par le maestro. Mais le vrai point d’orgue arrive à la dernière scène où, avec le Requiem de Berlioz en fond sonore, Sean Penn (c’est l’enfant devenu adulte) fait un voyage mystique au royaume des morts pour retrouver toute sa famille. Qui a dit que la frontière entre le sublime et le ridicule était mince ?
Pablo Galonce

« Je suis la Geneviève de Fontenay du classique ». Aie ! « Une Star’Ac du piano ». Re-aie ! Pour présenter Les Virtuoses du cœur (Aie puissance 3), Jean-Michel Jamet ne recule devant aucune référence. L’idée de cet ex-homme d’affaires (Marionnaud, American Express) reconverti dans la musique est pourtant judicieuse : puisque le piano est l’instrument bourgeois par excellence et que nombre de gens disposant d’un (très) grand salon organisent chez eux des récitals privés, pourquoi ne pas organiser un concours à l’échelle nationale ? Où que vous soyez en France, l’association vous met en relation avec un jeune virtuose de la région, qui va venir jouer chez vous. Le public répond à un questionnaire (« Programmeriez-vous cet artiste à la salle Pleyel ? ») permettant d’éliminer ou de sélectionner les impétrants, dont certains sont d’ores et déjà parrainés par des anciens (Marie-Josèphe Jude, François Chaplin). Viendront ensuite, jusqu’en mars 2012, des finales départementales, régionales et nationales. Deux mille concerts éliminatoires sont prévus jusqu’en octobre, déplaçant quelque cent mille spectateurs, lesquels sont invités à participer à une double bonne action, puisque une partie de leurs droits d’entrée est reversé à l’association Coline en ré, destinée à offrir des soins chirurgicaux aux enfants des pays défavorisés. « Entre Star’Ac et Un dîner presque parfait, lit-on dans Le Figaro, mais sans caméra ». Eh oui ! Un pianiste trimant sur son clavier ne sera jamais aussi glamour que Jennifer ou Nolwenn Leroy.
François Lafon
www.lesvirtuosesducoeur.com
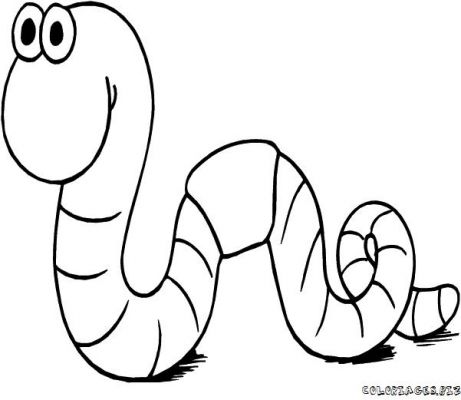
Savez-vous ce que c’est qu’un Ohrwurm ? En allemand, cela veut dire « ver d’oreille ». Métaphoriquement parlant, il s’agit d’une musique qui s’insinue dans votre oreille et ne veut plus en sortir. En anglais, on dit earworm (traduction littérale d’ohrwurm) ou musical hitch, qu'on pourrait traduire par « démangeaison musicale », à ne pas confondre avec a hook (littéralement « un hameçon », formule mélodique ou rythmique qui capture l’attention, tel le début de la 5ème Symphonie de Beethoven). Selon James Kellaris, professeur à l’Université de Cincinnati, « ce phénomène est susceptible de toucher 97 à 99% de la population, les femmes et les musiciens étant les plus concernés ». Est-ce à dire que les femmes ont plus d’oreille que les hommes (les musiciens étant bien sûr hors concours) ? En 1956, l’écrivain d’anticipation Arthur C. Clake (auteur de 2001, l’Odyssée de l’espace) a publié une nouvelle, The Ultimate Melody, dans laquelle un savant sadique invente une mélodie fatale et inoubliable, correspondant exactement aux rythmes électriques fondamentaux qui animent le cerveau. En est-on là quand on n’arrive pas à se débarrasser d’une chanson - bien souvent stupide et hautement oubliable -, entendue le matin à la radio ? Dans les pays anglo-saxons, ce phénomène est pris très au sérieux par les spécialistes de neuro-imagerie, mais alimente aussi les médias : les auditeurs du Shaun Keaveny Breakfast Show, émission très populaire de BBC 6 Music, sont priés de faire savoir en compagnie de quel earworm ils se sont réveillés. En France, on parle de scie (chanson, formule, argumentation ressassée et usée), de rengaine (refrain banal, chanson ressassée - de rengainer : remettre dans la gaine) et l’on se plaint qu’un air nous trotte dans la tête, mais aucun ver d’oreille hexagonal ne s’est insinué dans le langage.
François Lafon
Dessin extrait de www.coloriages.biz

Faut-il aller voir Pirates des Caraïbes 4 ? Pas vraiment : dans sa version en simple “2D”, ce blockbuster est assez pénible à regarder, et on ne voit pas ce que la version en 3D sortie en même temps peut apporter sauf peut-être la sensation de plonger dans le décolleté généreux de Penélope Cruz, la vedette féminine. Dirigé très poussivement par Rob Marshall, cet avatar des aventures de Jack Sparrow (Johnny Depp, en roue libre) n’a même pas l’humour truculent qui sauvait les trois précédents volets mis en scène par Gore Verbinski. La bande son est à l’avenant : une partition tonitruante comme Hans Zimmer sait bien les composer. Un seul moment dans le film retient pourtant l’oreille : quand le très catholique Roi d’Espagne, sous les traits d’un beau brun ténébreux comme il se doit (depuis le XVIè siècle tous les monarques espagnols sont plutôt blonds aux yeux bleus, mais on aura compris que l’exactitude historique n’est pas vraiment le souci du scénario) arrive en personne pour détruire la Fontaine de l’Eternelle Jouvence (que par ailleurs tout le monde cherche, vous suivez encore ?), on entend très nettement les notes du “Dies Irae”, partie essentielle de la Messe des Morts médiévale, tout comme dans le Sabbat de la Symphonie fantastique de Berlioz. Hans Zimmer (allemand, et pas américain) aime ce genre de clin d’oeil : déjà dans sa partition pour Gladiator de Ridley Scott, au moment où Russell Crowe se sent condamné, il avait introduit presque note par note le thème de la mort du héros du Ring de Wagner. Difficile d’échapper à une petite interprétation théologique de ce nouveau clin d’oeil. D’autant plus que le scénario de Pirates des Caraïbes 4 tourne lourdement autour du thème de la rédemption, et qu’on y voit même un pasteur protestant (incarné, lui, par un blond bien anglo-saxon passé par une salle de gym) essayer de sauver l’âme d’une sirène. Pourquoi alors associer le Roi catholique au “Dies Irae” : pour le désigner comme l’instrument de Dieu (il vient après tout détruire la Fontaine au motif qu’il s’agit d’un instrument païen) ou au contraire pour souligner le danger mortel que les catholiques représentent ? Presque millénaire, le “Dies Irae” est en train de devenir un lieu commun de la musique de film : Stanley Kubrick ouvrait déjà The Shining avec ce même thème, joué aux synthés par Wendy Carlos, avec un effet terrifiant et solennel. Mais là on parle de vrai cinéma...


