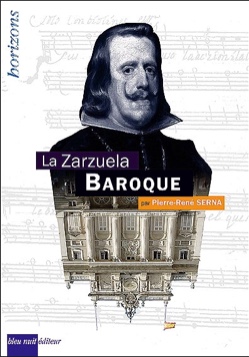- octobre
- août
- juillet
- juin
- mai
- avril
- mars
- février
- janvier