Dans le superbe film de Jacques Audiard Un Prophète, par exemple, la musique vient quand il le faut, et tous les styles sont bons. Mais quand le film se termine, quand le petit casseur est devenu un pro du crime via l'école (de la) centrale, Audiard trouve la note qui nous emporte : la Complainte de Mackie (« Mackie, lui, a un couteau, mais le couteau, on ne le voit pas » ), qui ouvre L'Opéra de Quat'sous de Brecht et Weill. Le procédé est connu, et ladite Complainte a été mise à toutes les sauces, mais cette fois, cela colle vraiment. Du coup, on redécouvre le génie sous la rengaine.
On croit rêver ! Imaginez une table ronde réunissant, dans le cadre très officiel de la New York Public Library, les metteurs en scène Luc Bondy, Patrice Chéreau et Bartlett Sher, en compagnie de Peter Gelb, le directeur du Metropolitan Opera. Sujet de l'entretien : la nouvelle mise en scène, au MET, de Tosca par Bondy, remplaçant celle, furieusement traditionnelle, de Franco Zeffirelli. Le public a hurlé sa rage, relayé par les critiques. Les objets du scandale ? Le baiser à la statue de la Vierge au premier acte ? Les prostituées avec lesquelles Scarpia s'amuse au deuxième ? Oui, mais surtout, l'absence du jeu de scène qui d'habitude clôt ce deuxième acte, où l'on voit Tosca décrocher un crucifix du mur et le poser sur le cadavre de Scarpia qu'elle vient de poignarder, après avoir disposé deux chandeliers de part et d'autre dudit cadavre, tout en chantant : « Et devant lui, tout Rome tremblait ». Bondy, pour l'occasion, est obligé de rappeler que ce final n'avait pas été prévu par Victorien Sardou, l'auteur du drame duquel Puccini a tiré son opéra, et qu'il avait été inventé par Sarah Bernhardt, la créatrice du rôle. Sait-il aussi que ce jeu de scène, devenu si célèbre qu'un dessin le représentant illustre la couverture de la partition de l'opéra, avait fait scandale lors de la création de la pièce à New York, et que Fanny Davenport, la Sarah Bernhardt américaine, avait dû le supprimer ? Certains critiques, tel Alex Ross du New Yorker, font remarquer que Puccini l'a indiqué dans sa musique : un accord pour le premier chandelier, un autre pour le second, un troisième pour le crucifix, le tout couronné par le thème (sinistre) de Scarpia. « Je ne savais pas que Tosca à New York, c'était comme la Bible », a ajouté Bondy. Les lyricomanes new yorkais feront moins d'histoires en voyant au MET De la Maison des morts dans la superbe mise en scène de Chéreau. Janacek, au Lincoln Center, cela ne sera jamais la Bible.
Selon le musicologue italien Luca Chiantore, La Lettre à Elise ne serait pas de Beethoven. Enfin, pas complètement. Ce serait le musicologue Ludwig Nohl, connu pour l'avoir découverte en 1865, qui aurait terminé l'illustre bagatelle à partir d'une esquisse de la main de grand homme. On pensait déjà que c'était Nohl qui avait rebaptisé Elise la véritable dédicataire, Therese Malfatti von Rohrenbach zu Dezza, sur laquelle Ludwig Van a eu des vues dans les années 1810, à moins qu'il ne se soit agi de la cantatrice Elisabeth Roeckel, la sœur du ténor qui a chanté Florestan dans Fidelio en 1806, et dont le surnom était Elise. Comme on possède par ailleurs, de la main de Beethoven, des esquisses proches de la version définitive, Nohl risque de rester à sa place et Chiantore à la sienne.
Pauvre Beethoven ! Il n'a déjà jamais eu de chance en amour, il faut encore que, de l'énigmatique Elise à l'Immortelle Bien-Aimée, la postérité se casse la tête à découvrir l'identité des élues de son cœur.

Vous en avez assez d'imiter Karajan devant la glace de la cheminée ? Vous êtes saisi par une envie irrépressible de diriger, en vrai, de chez vous, l'Ouverture « 1812 » de Tchaïkovski ? Qu'à cela ne tienne : avec mille téléphones portables, deux mille SMS, quelques mois de travail, une équipe performante (dont un Network Gourou), vous pouvez réaliser votre rêve. C'est ce qu'un Néo-Zélandais nous prouve, vidéo à l'appui. Certes, l'exécution finale, où l'on voit le mur de portables clignoter comme une carte de commissariat un soir de Fête de la musique, ne dure que trente-huit secondes, et le rendu sonore évoque davantage le synthé aigre de la pionnière Wendy Carlos que le velours du Philharmonique de Berlin. Mais c'est le making of qui est hallucinant. Car il ne suffit pas de répartir les sons sur les téléphones et de coordonner l'ensemble, il faut d'abord les produire, ces sons. Et là, on fait appel aux méthodes qu'utilisait Karajan : on enregistre de vrais instrumentistes. Il y a même une séance d'applaudissements, avec de vrais gens frappant leurs mains l'une contre l'autre. Moralité : si vos enregistrements de l'Ouverture « 1812 » ne vous suffisent plus (mais pourquoi, d'ailleurs, vous fixer sur cette horreur, alors que Tchaïkovski a produit tant de jolies choses ?), faites établir un devis : il n'est peut-être ni plus onéreux ni plus compliqué d'inviter chez vous le Philharmonique de Berlin que de vous offrir trente-huit secondes de SMS en folie.
Exposition au musée du Jeu de Paume, hommage à la Cinémathèque, livres et DVD : c'est la fête à Fellini. Seize ans après sa mort, le cinéma ne sait toujours pas très bien dans quelle case ranger l'homme aux titres auto-signés (Fellini-Roma, Fellini-Satyricon). On a souvent dit que ses films étaient des opéras sans musique (si ce n'est celle de Nino Rota, qui a écrit des opéras… pour d'autres). Parce qu'il était italien ? Parce que la démesure était devenue sa marque de fabrique ? Il n'a, en tout cas, pas cédé au producteur Daniel Toscan du Plantier, qui voulait faire tourner des « filmopéras » à tout le monde, et y est arrivé avec quelques-uns (Rosi, Comencini, pour ne citer que les Italiens). A deux reprises, Fellini a touché à la musique, ou tout au moins aux musiciens : dans Prova d'orchestra (1979) et E la Nave va… (1983). Ce ne sont pas ses films les plus fêtés. Le premier, qui donne une répétition d'orchestre comme métaphore du monde, a été jugé réactionnaire ; le second, qui raconte le retour par bateau des cendres d'une cantatrice célèbre, trop esthétisant. C'est bien sûr l'occasion de les voir ou de les revoir. Qui prétendra que les caprices d'un maestro omnipotent ne sont plus à l'ordre du jour en Italie, et qu'une croisière people aux relents de cadavre ne parle plus au public de notre temps ?
Tutto Fellini.
Musée du Jeu de Paume : exposition Fellini, la grande parade. Du 20 octobre 2009 au 17 janvier 2010.
Cinémathèque française : rétrospective du 21 octobre au 20 décembre.
Institut Culturel Italien : rencontres, avec le soutien de la Fondation Fellini. Le 16 novembre : leçon de ciné-musique avec Nicola Piovani.
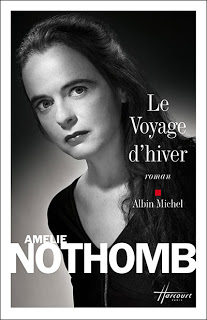
Le Voyage d'hiver, d'Amélie Nothomb. Albin-Michel, 136 p., 15 euros
Mon Voyage d'hiver, de Vincent Dieutre. 1 DVD Optimale « Rainbow Classics »

Voir jouer Alicia de Larrocha, qui vient de mourir (le 26 septembre 2009) à quatre-vingt six ans dans sa Barcelone natale, était à la fois fascinant et très amusant. Outre une silhouette de gentille dame tranquille, la grande pianiste ibérique du demi-siècle avait de toutes petites mains. On s'attendait donc à ce qu'elle se cantonne à un répertoire intimiste. Mais comme le répertoire, intimiste ou pas, présuppose que la main de l'interprète couvre au moins l'octave, et comme la gentille dame était pourvue d'un tempérament de feu, Alicia de Larrocha n'a jamais cessé de contredire les apparences. Elle a tacitement dissuadé nombre de ses confrères de se lancer à sa suite dans Albéniz et Granados, mais elle n'a pas hésité, elle, à faire siens Mozart et Beethoven, Debussy et Fauré. Et tant pis pour Rachmaninov, qui possédait lui-même de grandes mains, et n'a composé que pour ses semblables. Quand vous écouterez les disques (il y en a beaucoup, et d'excellents) d'Alicia de Larrocha, ne perdez jamais de vue la gentille dame aux petites mains.
« Le Bottin est le livre que j'aimerais emporter sur une île déserte, parce qu'avec tous les noms qu'il contient, on peut imaginer quantité d'histoires. » On n'en attendait pas moins d'Umberto Eco, qui pendant un mois et demi, fait tanguer le Louvre de sa picdelamirandolesque culture. Au sein de ce « Vertige de la liste », qui nous promet soixante-trois lectures, une exposition, une chambre des merveilles, cinq conférences, huit documentaires, un livre, un catalogue, un spectacle, un colloque et cinquante-et-un intervenants, se glissent trois concerts. Et quels concerts ! On y trouve des litanies d'auteurs anonymes du XVIème siècle listant les mérites de la Vierge, un « Inventaire avant disparition », puisé dans Les Archives de la Planète du banquier philanthrope (sic) Albert Kahn et illustré par le DJ Laurent Garnier, ou encore des œuvres de Luciano Berio par l'Atelier Lyrique de l'Opéra de Paris.
Eco et Berio ont longtemps fait cause commune, le second trouvant dans les recherches du premier sur le langage un écho à son propre travail de compositeur, lequel a de plus en plus consisté à confronter, empiler, mélanger et retraiter les couches sonores issues de cinq siècles de musique. Ce serait bien, pour la musique, d'avoir son Umberto Eco. Un Nom de la rose dont l'énigme reposerait sur l'interprétation des neumes, des Promenades dans le bois du concert, un Dire presque la même chose traitant non plus de la traduction, mais de la transcription… Le terme de « musique contemporaine » nous promettrait un voyage érudit mais ludique, au lieu du parcours du combattant auquel nous invitent encore les grognards de la défunte avant-garde.
Le Louvre invite Umberto Eco, du 2 novembre au 13 décembre.
A lire :
Vertige de la liste, d'Umberto Eco, Flammarion, 408 p., 39 euros.
N'espérez pas vous débarrasser des livres, entretiens d'Umberto Eco avec Jean-Claude Carrière. Grasset, 342 p., 18,50 euros.


« Les Quatre Derniers Lieder de Richard Strauss. Pour la profondeur obtenue, non par la complexité, mais par la clarté et la simplicité. Pour la pureté avec laquelle s'exprime le sentiment de la mort, de la séparation et du deuil. Pour la longue ligne mélodique qui se déroule tandis que la voix de femme s'élance vers les sommets. Pour la grâce, la sérénité, la parfaite maîtrise, l'intensité de la beauté avec lesquelles cette voix s'élance. Pour la façon dont on est entraîné dans la puissante courbe parabolique de la douleur. Le compositeur laisse tomber tous les masques, et à l'âge de quatre-vingt-deux ans, il se tient nu devant vous. Et vous vous fondez en eau. » (p. 144-145)
Si elles venaient d'un livre sérieux, par exemple d'un Richard Strauss publié par Fayard (l'éditeur de référence des musicos), ces considérations passeraient pour des généralités, de la littérature inutile, de la musicologie pour prime time télévisuel. On ne manquerait pas de remarquer que Strauss avait quatre-vingt quatre ans, et non quatre-vingt deux, quand il a composé ses Quatre Derniers Lieder. Mais voilà, c'est dans un roman qu'on les trouve, et pas n'importe lequel : Exit le fantôme de Philip Roth (1). C'est-à-dire qu'il faut non seulement les replacer dans leur contexte, mais les mettre en perspective. Qui parle ? Dans quelle situation ? Est-ce l'opinion de l'auteur ou de l'un de ses personnages ? Du coup, ces envolées que tout straussophile est en droit de traiter par le mépris prennent un autre relief, acquièrent même un certain mystère. Comme le narrateur du roman n'est autre que Nathan Zuckerman, dont on nous a dit et redit qu'il était le double de Roth lui-même, tout se complique encore. Le drame de cet écrivain qui se croit (à tort, c'est là toute l'histoire) affranchi de ce que l'âge et la maladie lui interdisent est tout entier résumé dans ce paragraphe.
Un peu plus loin dans le roman, on apprend qu'un autre écrivain, génial et oublié, modèle problématique pour Zuckerman-Roth qui vit si mal (si mal que cela ?) sa condition de « plus grand écrivain américain vivant » (oui, mais quand il sera mort ?) a eu pour derniers mots : « La fin est si immense qu'elle contient sa propre poésie. Il n'y a pas à faire de rhétorique. Juste dire les choses simplement. » (p. 176). Un bel écho au « serait-ce déjà la mort ? », qui clôt le dernier des Quatre Derniers Lieder, non ?
Tout cela pour rappeler qu'écrire sur la musique n'est que littérature ? Que ce n'est jamais de musique que l'on parle, mais de soi-même en train d'en écouter, ou plutôt d'en rêver ? Lieux communs, là aussi. Et alors ? Roth le fait avec son génie particulier, comme Ingmar Bergman l'a fait à sa manière dans son dernier film, Sarabande. Le jour est encore loin où les génies empêcheront tout à chacun de commenter ses rêves.
(1) Exit le fantôme, de Philip Roth. Traduit (pas toujours adroitement, mais le style de Roth est plein de chausse-trappes) par Marie-Claire Pasquier. Gallimard, 328 p., 21 euros
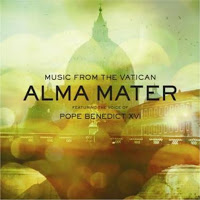

Le chef d'orchestre (fort accent russe) : « Je vous baise chaleureusement ». La jeune et jolie violoniste : « Le fameux tempérament slave, n'est-ce pas » ? Le teaser du film Le Concert, réalisé par Radu Mihaileanu (à qui l'on doit Va, vis et deviens), annonce la couleur. L'idée de départ n'a pourtant rien de graveleux : un chef célèbre relégué au rang de technicien de surface pour avoir protégé des musiciens juifs (nous sommes à l'époque de Brejnev) intercepte un fax invitant l'Orchestre du Bolchoï à Paris. C'est lui qui viendra, avec un ensemble de musiciens en disgrâce. Alors pourquoi verser dans le racolage ? Pour montrer que, bien que se passant dans le milieu de la musique classique, le film n'est ni guindé ni exagérément culturel ? Au cinéma, ce blocage récurrent nous a valu quelques jolis ratages, de la très branchée Femme de ma vie de Régis Warnier, où l'on voit un violoniste éthylique remonter au sommet de l'affiche avec une vitesse relevant du miracle, au récent Clara, de Helma Sanders-Brahms, mélo vaudevillesque mettant en scène le couple Schumann face au jeune Brahms (Johannes). Jacques Audiard lui-même, dans De battre mon cœur s'est arrêté, frôle le précipice, avec son héros-voyou sauvé par son amour pour le piano. Le Concert sort le 4 novembre. Sera-t-il l'exception qui confirme la règle ?
Le Concert, de Radu Mihaileanu, avec Mélanie Laurent, Miou-Miou, François Berléand. Sortie nationale le 4 novembre.
Crédit photo : © EuropaCorp Distribution




